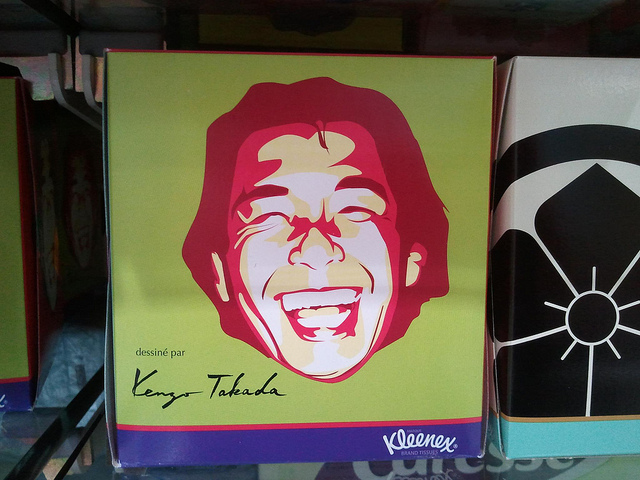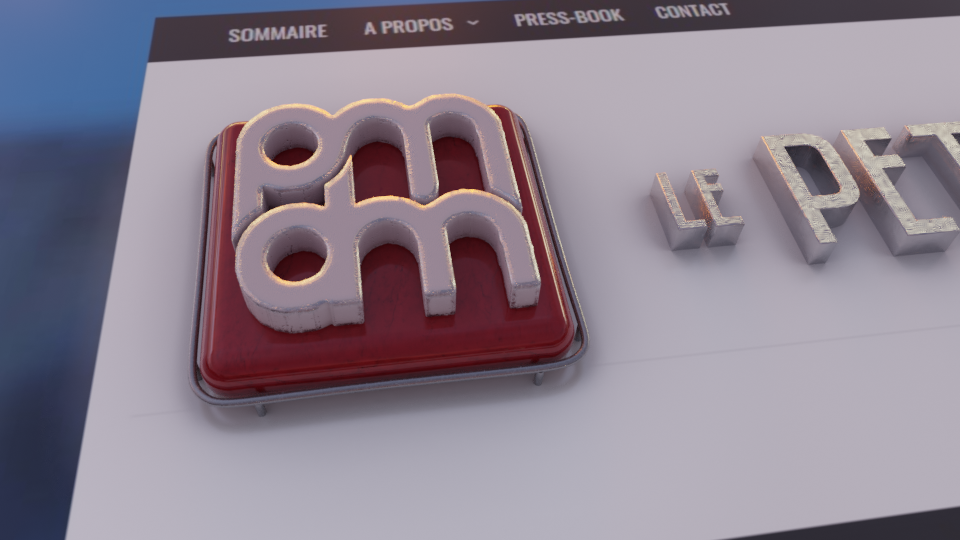Source : Kenzo Takada attaque en justice LVMH pour exploitation abusive d’une marque (AFP via Yahoo! Actualités ; via Nouvel Obs) [Merci à Benjamin, de Droit du Divertissement, pour l’info]
Schéma classique [1] : une personnalité autorise le dépôt comme marque de son patronyme par une société avec laquelle il collabore. Les parties s’éloignent, leurs chemins se séparent. La titularité des droits sur cette marque et leur exploitation postérieure à la rupture deviennent source de conflit.
En 1993, Kenzo Takada vend sa société Kenzo SA au groupe LVMH pour 29 millions d’euros et devient consultant de la société pour les aspects créatifs, mais à titre indépendant. En 1997, LVMH rétrocède (pour un franc symbolique) au créateur les marques «Kenzo Takada». Par la suite, envisageant de vendre sous son nom des produits liés à l’art de vivre, M. Takada se serait aperçu « en voulant déposer sa marque en idéogrammes chinois au Japon, fin 2000-début 2001 » que LVMH exploitait ce sigle. Il a donc assigné le groupe de luxe et réclame une provision de 6 millions d’euros à valoir sur les dommages et intérêts ainsi que la désignation d’un expert chargé d’évaluer le montant exact de son préjudice.
Particularité de l’espèce : c’est deux types de marques qu’il conviendrait, selon la défense, de distinguer : l’un correspondant au nom en caractères latins, l’autre au patronyme en caractères chinois.
Selon l’avocat de LVMH, le protocole signé en 1997 qui permettait à la société Kenzo SA de continuer à utiliser le nom « Kenzo » visait la rétrocession des seules marques portant sur le nom et le prénom Kenzo Takada en lettres latines : la société Kenzo SA demeurerait libre d’utiliser les caractères chinois.
L’affaire, placée devant la 3è chambre du TGI de Paris a été mise en délibéré au 11 mai.
[ Mise à jour 3 juin 2005 ] : l’affaire se termine par un compromis : un accord dont les termes restent confidentiels aurait été trouvé (source : Nouvel Obs 1/6/05 –merci Cédric–).
_____________
[1] : voir l’affaire Inès de la Fressange et lire également à son propos le commentaire de Christophe Caron sous l’arrêt du 15 décembre 2004, dans la revue Communication Commerce Electronique, février 2005, page 46.